|
|
|
Milieu naturel
Enfouissement des lignes
Plus de 4% du réseau 225 000, 90 000 et 63000 volts de RTE est
aujourd'hui enfoui. La longueur du réseau aérien diminue chaque
année.
En 1999, 705 MF ont été consacrés à l'enfouissement des
réseaux de transport. Depuis 5 ans, 3,2 milliards de francs ont été
dépensés à cet effet.
Coût d'investissement des ouvrages en millions de
francs
au 01/02/2001 par kilomètre
(Extrait du Rapport Piketty
- Février 2001 - Conseil Général des Mines)
| Tension |
|
63/90 kV |
225 kV |
400 kV |
| Aérien |
Zone rurale |
1 à 1.4 |
1.5 à 3 |
3 à 6 |
| |
Zone urbaine |
1.5 à 2* |
3 à 6* |
4 à 8 |
| Souterrain |
Zone rurale |
2 à 4 |
4 à 6 |
|
| |
Zone urbaine |
3 à 8 |
5 à 12* |
|
* estimation théorique dans la
mesure où l'essentiel des lignes nouvelles est désormais
enfoui.
|
Ce tableau est
particulièrement mensonger.
Les " fourchettes "
mentionnées par RTE négligent toute une série de
paramètres qui sont favorables aux ouvrages enfouis ou
immergés et défavorables aux lignes aériennes.
Il
s’agit ici de ratios qui ne tiennent compte que des coûts
à l’investissement, sans prendre en compte les coûts
d’exploitation, ordinaires ou exceptionnels (comme les dégâts
causés aux lignes aériennes par les intempéries).
Ils ne tiennent pas compte non plus des économies réalisées
en termes de pertes, lesquelles sont moins importantes en technologie
non aérienne qu’en technologie aérienne. C’est
ce que confirmait clairement M. Alain LEBRETON, président du
comité technique de l’électricité (CTE)
auprès du ministre de l’Industrie lorsqu’il
déclarait, le 26 mai 1998 (communication fait à Toulon
dans le cadre du Débat public relatif au projet
" Boutre-Carros ") : " Le
coût des câbles varie beaucoup avec le coût de la
pose : mode, nature du sol, occupation du terrain. Toutefois,
les pertes de transport sont moins élevées. Si on
capitalise le gain correspondant et si l’on en tient compte dans
la comparaison, le rapport aérien sur souterrain est à
peu près divisé par deux… ". Et
le président du CTE d’ajouter : " …Il
font donc se préparer, techniquement et économiquement,
à moins construire en aérien, à construire plus
en souterrain et, en tous cas, à ne pas augmenter la longueur
du réseau aérien HTB existant et à réduire
celle du réseau HTA… ".
La
tableau laisse aussi supposer que l’enfouissement n’est pas
possible en classe EHT/400 kV puisqu’aucun chiffre n’est
donné pour cette catégorie d’ouvrages. A ce
propos, M. Lebreton disait, toujours en mai 1998, que : "
…il s’agit, pour le 400 kV, de tronçons de
courtes longueurs (inférieures à 20 km) adoptés,
soit pour des raisons techniques (40% des cas) ou politiques et
environnementales (60% des cas)… "
Nous sommes donc bien
loin de la soi-disante " impossibilité
d’enfouissement " qui demeure le credo du duo RTE-EDF.
Il est cependant exact que la plupart des liaisons existantes sont de
courtes longueur. En courant alternatif, l’une des plus longues
demeure la liaison sous-marine du détroit de Vancouver ( en
525 kV) dont la longueur est de 38 km. Par contre, il existe des
liaisons 400 kV en courant continu qui font plus de 200 km de long.
En
ce qui concerne les coûts, il est très difficile de
donner des " fourchettes ", surtout en 400 kV où
il s’agit de faire des estimations cas par cas. Comme
l’indiquait fort bien Alain Lebreton, les coûts effectifs
dépendent d’un grand nombre de paramètres et de
choix techniques. C’est ainsi qu’avec des câbles
" classiques " (câbles à huile ou
câbles secs), le ratio moyen s’établira entre 6 et
12. Mais il oscille entre 3 et 5 avec les liaisons à isolation
gazeuse (LIG, CIG ou TGT), comme l’indique une note émanant
du groupe Alcatel-Câbles ( aujourd’hui rebaptisé
" Nexans "). Elle émane du service
" Information et documentation " de ce groupe
câblier et date d’octobre 1994. Dans son numéro de
septembre 1999, la revue " Instantanés techniques "
(revue trimestrielle des " techniques de l’ingénieur ")
consacrait également un article aux liaisons souterraines à
isolation gazeuse. On pouvait y lire la mention suivante :
" …Avec la LIG, l’investissement est de 10
fois celui d’une ligne aérienne équivalente, mais
le coût tombe à 5 fois seulement en valorisant
l’économie apportée par la réduction
considérable des pertes. Il faudrait ajouter à cette
considération l’économie des surcoûts
d’exploitation… ". Cette mention
est en parfait accord avec les déclarations du président
du CTE ainsi qu’avec les estimations du groupe Alcatel. Elles
sont aussi conformes aux estimations données par Daniel Depris
dans son ouvrage consacré aux réseaux électriques
souterrains, immergés et sous-marins.
Il ne faut pas non
plus négliger le fait que les marchés relatifs aux
ouvrages électriques souterrains ou immergés sont
presque toujours entachés d’anomalies financières,
essentiellement des surfacturations faites au plan national pour
compenser le dumping consenti par les câbliers français
au niveau international.
Outre le fait que ces
procédés sont illégaux, ils faussent les calculs
de comparaison.
En cette année
2002, on peut considérer que, dans le cas des liaisons HTB
63/90 kV, le coût effectif d’une liaison souterraine ou
immergée est égal ou légèrement inférieur
à celui d’une ligne aérienne équivalente,
du moins si l’on effectue un calcul complet sur la base de la
durée de vie comptable d’un ouvrage (40 ans). Pour la
classe THT/225 kV, la liaison non aérienne sera, en ordre
moyen, entre 1,5 et 2,5 fois plus chère qu’un ouvrage
aérien. Ces calculs n’intègrent pas les coûts
dits " impondérables " comme ceux qui
résultent, par exemple, des dégâts provoqués
par les tempêtes.
Remarque
importante : Il faut aussi rappeler que l’avènement
des câbles supraconducteurs (SC) va bouleverser la conception
des réseaux électriques dans les années à
venir. Les câbles SC – qui ne génèrent pas
de pertes par résistance (l’effet Joule étant nul)
– devraient permettre de limiter la tension de transport entre
200 et 250 kV. En effet, une liaison 225 kV de type SC a une capacité
de transport équivalente à celle de deux lignes
aériennes 400 kV. La première liaison SC est en service
a Détroit (USA). Elle a été réalisée
à l’aide de câbles développés par le
groupe Pirelli, en collaboration avec AMSC (fabricant américain
de matériaux supraconducteurs) et EDF (actionnaire d’AMSC).
Fonctionnant sous 24 kV, elle a la même capacité de
transport qu’une liaison classique de 110 kV.
|
La France est un des pays les plus avancés pour
l'enfouissement du réseau 225 000 volts. Elle est bien placée pour les
lignes 90 000 et 63 000 volts, compte tenu notamment de sa densité de
population.
|
La France, si elle est effectivement un peu mieux placée que les autres pays européens en ce qui concerne l’enfouissement de son réseau 225 kV, est GLOBALEMENT EN RETARD dans le domaine de l’assainissement et de la sécurisation de ses réseaux électriques.
|
Où en est-on ?
Dans l'annexe "environnement" du contrat
d'entreprise de 1997-2000, l'engagement avait été pris d'enfouir 20 % des
nouvelles lignes 90 000 et 63 000 volts.
26.6% de nouvelles lignes ont été réalisées en
souterrain.
Au total, plus de 2000 km en 90 000 et
63 000 volts et plus de 800 km en 225 000 volts ont d'ores
et déjà été enfouis. La priorité est donnée aux zones urbaines
et périurbaines où la densité de population est la plus
forte.
Enfin, RTE poursuit plusieurs voies de recherche
sur l'enfouissement des lignes permettant d'envisager une amélioration de
leur performance et surtout une diminution de leur coût.
Peut-on tout enfouir ?
Sur les lignes 400 000 volts
Il est techniquement très complexe et très coûteux
d'enfouir les lignes 400 000 volts :
|
L’enfouissement
d’un ouvrage 400 kV n’est pas plus complexe que
l’enfouissement d’un ouvrage 63, 90 ou 225 kV, d’autant
que l’on enterre des ouvrages de ce type depuis 1942, autrement
dit depuis plus d’un demi-siècle.
C’est d’ailleurs
une firme câblière française (Câbles de
Lyon) qui a fournit les premiers câbles 500 kV commandés
par un producteur suédois, en 1956. Il s’agissait, à
l’époque de câbles à isolation huile-papier
(câbles à huile fluide). C’est une autre entreprise
française (Silec, aujourd’hui Sagem) qui a fait
homologuer (par EDF) le premier " câble sec "
(isolation synthétique) en classe 400-500 kV et ce, en 1985.

Ci-dessus,
vue en couple du câble 500 kV produit, dans la seconde moitié
des années 50, par les « Câbles de Lyon »
(document extrait du catalogue général de 1960). Ce
type de câble a été fabriqué à la
demande de producteurs suédois d’électricité
et installé à Grundfors et à Stornorrfors. Les
circuits ainsi équipés pouvaient transporter 1.400 MVA
en régime permanent (sous 500 kV) avec un section conductrice
en cuivre de seulement 405 mm².
En
1986, le groupe Pirelli a fait homologuer, en Italie, un câble
capable de supporter une tension alternative de 1.100.000 volts (1100
kV ou 1,1 MV). Il faut donc dénoncer haut et fort, les
manœuvres de désinformation visant à laisser
croire, aux personnes non averties, que le transport, par câbles,
des extra et ultra hautes tensions (EHT de 300 à 600 kV et UHT
de 600 à 1200 kV) n’est pas possible techniquement. C’est
pourtant ce qu’osent encore prétendre les
« communicants » d’EDF/RTE et même
certains pseudo-journalistes à la solde des lobbies (comme le
dénommé Jean Vermeil qui a osé affirmer, dans un
article du « Nouvel Observateur » (n°1590 –
1995 – EDF réinvente les pylônes) que « Quant
à enterrer la très haute tension (400.000 volts),
personne ne maîtrise encore les contraintes d’isolation
que cette technique exige… » ! ! !
En date du 27 avril
1995, la présidence du CEPHES avait adressé une lettre
de protestation à M. Jean Daniel, rédacteur du Nouvel
Observateur lequel, bien entendu n’a jamais répondu à
notre courrier. Ce mutisme confirme ce que nous pensons sur la
collusion qui existe entre les désinformateurs professionnels
d’EDF/RTE et du ministère de l’Industrie d’une
part, et la grande presse française. Un incident du même
genre a opposé la présidence du CEPHES à la
rédaction de « Marianne », M.
Jean-François Kahn ayant, lui aussi refusé de
s’expliquer à propos des mensonges grossiers que son
hebdomadaire avait publié en janvier 2000.
Lorsqu’ils sont
pris en flagrant délit de désinformation, les
journalistes français pratiquent la politique de l’autruche
et du « silence radio ». C’est la raison
pour laquelle le CEPHES continue à revendiquer l’adoption
d’une législation permettant de poursuivre, sur le plan
pénal, les individus qui se rendent coupables des délits
de désinformation et de manipulation. Une telle loi
permettrait de faire citer les « communicants »,
les journalistes, les fonctionnaires et les dirigeants politiques qui
persistent à mentir honteusement dans le seul but de couvrir
des pratiques industrielles inadmissibles. Actuellement, de telles
poursuites peuvent déjà être engagées en
vertu de la directive 90/313/CEE mais son application demeure limitée
et difficile. C’est ainsi qu’une plainte visant Dominique
Voynet – ex ministre de l’environnement – n’a
jamais été prise en considération par les
autorités compétentes.
Le
CEPHES n’hésitera cependant pas à faire connaître
les noms des personnes, des journaux et des organismes qui se rendent
coupables de ces délits, comme Dominique Voynet, Dominique
Strauss-Kahn, Christian Pierret, Martin Malvy, Franck Sérusclat
ou Christian Kert (entr’autres), le « Nouvel
Observateur » et « Marianne »
(entr’autres), le ministère de l’Industrie, le
ministère de l’Environnement et les DRIRE (entr’autres
organismes officiels). Sans oublier les « communicants »
et autres agents d’EDF et de RTE.
A
noter que la manipulation des parlementaires est assurée, à
l’intérieur même du parlement français, par
le député Jean-Claude Lenoir (UDF), ancien directeur du
service « Relations avec les élus » de
la direction-générale d’EDF. Il dirige un noyau de
députés et de sénateurs que les clairvoyants
surnomment « groupe des apparentés EDF ».

Ci-dessus,
on retrouve les principaux mensonges distillés par la
rédaction de « Marianne » dans son n°
142 du 10 janvier 2000 (article signé par le dénommé
Jean-Claude Jaillette, l’un des « coordinateurs »
de la rédaction). La méthode de désinformation
utilisée par « Marianne » -
particulièrement vicieuse - consiste à mélanger
des mensonges grossiers avec des informations correctes. On notera
que cet hebdomadaire, qui se qualifie lui-même
d’ « anticonformiste et anti-pensée-unique »
(sic), a reçu pas mal d’argent d’EDF-RTE par le
biais de la publicité « de prestige »
que ce groupe industriel utilise pour monnayer la complaisance des
rédactions. Cette publicité est, en fait, une forme
déguisée de corruption. Dans pas mal de cas, les
journalistes se contentent d’apposer leur signature au bas
d’articles qui ont, en fait été rédigés
par les « communicants » d’EDF-RTE. Mais
en cautionnant de leur nom des informations mensongères, il
leur appartient d’en assumer pleinement la responsabilité.
Il ne peuvent, en aucune façon, bénéficier de
« circonstances atténuantes ». La
déontologie journalistique exige qu’un rédacteur
(ou son éditeur responsable) vérifie l’exactitude
des informations qu’il diffuse. S’il ne le fait pas, il se
rend coupable de faute professionnelle grave. S’il est
incompétent dans le domaine abordé et s’il n’a
pas la possibilité de vérifier ses sources, il doit
s’abstenir de publier.
|
- L'enfouissement entraîne une déperdition de l'énergie
transportée. Pour y remédier, il faudrait construire tous
les 15 à 20 kilomètres des postes compensant cette
perte
d'énergie, qui couvriraient chacun une superficie
de plusieurs
hectares.
Il est tout-à-fait malhonnête de parler de " déperdition de l’énergie transportée " pour évoquer le phénomène de production d’énergie réactive. Il s’agit, en fait de " compenser " cette énergie réactive (ou " capacitive " car due à la valeur capacitive du câble, plus élevée que celle d’une ligne aérienne) en insérant des bobines spéciales (self dite " de réactance ") dans la liaison ou à ses extrémités. Cette compensation n’est d’ailleurs indispensable que si la longueur de la liaison est supérieure à une certaine valeur (variable selon la classe de tension considérée) et s’il s’agit de câbles à isolant solide. Elle n’intervient pratiquement pas avec les installations à isolation gazeuse.
Les véritables " pertes d’énergie " sont bien moins importantes avec les câbles qu’avec les lignes aériennes.
|
Pour obtenir l'équivalent d'une ligne aérienne
400 000 volts, plusieurs câbles en parallèle seraient nécessaires,
soit la largeur d'une véritable autoroute électrique de 20 mètres de large
dont le coût serait au moins de 10 fois supérieur à celui d'une
ligne aérienne.
|
L’argument selon
lequel une liaison 400 kV souterraine occuperait le même espace
qu’une « autoroute de 20 mètres de large »
est l’un des plus malhonnête mais aussi l’un des plus
fréquemment avancés (voir notamment l’article de
« Marianne »). Dans la réalité
concrète, la largeur de la bande de terrain dépend
essentiellement du type de technologie auquel on aura recours (câbles
à huile, câbles à isolation synthétique,
canalisations à isolation gazeuse, câbles
supraconducteurs), donc du choix des ingénieurs. Pour une
liaison 400 kV souterraine, la largeur de la tranchée sera
comprise entre 2 mètres dans le meilleur des cas et… plus
de 20 mètres si les ingénieurs optent pour la plus
mauvaise solution !
L’argument du duo
EDF-RTE est donc particulièrement spécieux. Il n’est
pas faux mais il ne vaut que si l’étude a été
faite par des « imbéciles diplômés » !
Nous devons donc conclure qu’il n’y a, chez EDF et RTE, que
des ingénieurs incapables d’étudier correctement
une liaison souterraine de type THT ou EHT. Mais nous sommes plutôt
enclins à penser que les véritables « incapables »
sont les responsables de la « communication » !
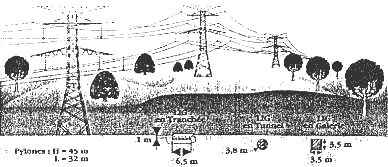
Ce document (source : Asea Brown Boveri – ABB) montre
l’emprise au sol comparée d’une ligne aérienne
380/400 kV et de trois liaisons LIG (isolation gazeuse) posées
respectivement « en tranchée » (pose en
nappe), « en tunnel » et « en
galerie ». Dans ces trois cas, l’emprise est comprise
entre 6 mètres et 3,5 m. Curieusement, la solution la moins
encombrante (pose en trèfle en tranchée) n’est pas
figurée sur ce dessin. Elle se contente d’une tranchée
d’environ 2 mètres de large. Par comparaison, la largeur
des nappes de conducteurs de la ligne aérienne équivalent
est de 32 mètres. Cependant, la largeur du « couloir
de nuisance » qui est associé aux lignes aériennes
de ce type peut être de plusieurs centaines de mètres.
Pour les liaisons souterraines correctement étudiées et
installées, les nuisances sont pratiquement nulles, qu’il
s’agisse des incidences esthétiques, écologiques
ou sanitaires.

Ce document (source ABB) montre comment les
ouvrages souterrains sont implantés en bordure des routes,
autoroutes et autres axes de circulation (voies navigables, voies
ferrées,…). L’emprise est ici de 3,5 m de chaque
côté d’une autoroute mais elle peut être
réduite à moins de deux mètres avec d’autres
types de câbles.

Cette photo permet de juger de la largeur effective d’une
tranchée destiné à recevoir les câbles
d’une liaison souterrain de grand transport. Il s’agit de
la partie terrestre de la liaison France-Angleterre (IFA 2000). Elle
permet de transporter 2.000 MW en passant sous la Manche. Elle se
compose de deux circuits à courant continu (on ne peut pas
raccorder directement les réseaux français et
britanniques qui ne sont pas techniquement compatibles, d’où
la nécessité de transporter l’électricité
sous forme de courant continu qui est retransformé en courant
alternatif). Si l’interconnexion s’était faite en
courant alternatif, la largeur de la tranchée aurait été
à peu près du même ordre (pour deux circuits
posés en trèfle jointif). Ce document est extrait du
rapport du groupe spécial 22 du Comité Technique de
l’Electricité (Ministère de l’Industrie –
1996). Il démontre que l’on est loin, vraiment très
loin, du « tunnel sous la Manche » ou d’une
« autoroute de 20 mètres » !
|
En cas d'incident majeur, la détection,
l'identification et surtout la réparation sur des câbles souterrains est
beaucoup plus complexe.
|
les " incidents majeurs " sont
rarissimes sur les liaisons souterraines ou immergées car la
fiabilité de ces ouvrages est beaucoup plus grande que celle
des lignes aériennes. En 1990, les statistiques relatives au
réseau EDF (portant sur 800 km de liaisons souterraines 225 kV
et sur 20 années d’exploitation) laissaient apparaître
un risque de panne tous les 17 ans pour 100 km de câbles. Avec
l’amélioration constante du matériel et le
remplacement progressif des anciens câbles « huile-papier »
par des câbles à isolation synthétique, les
résultats ne cessent de s’améliorer. Aujourd’hui,
le risque de panne est inférieur à une panne par 20 ans
pour 100 km de câbles. Il est entre 4 et 7 fois plus élevé
(en moyenne) avec les lignes aériennes.
Dans le cas où
un problème devait quand même survenir (ce qui ne peut
jamais être totalement exclu), la localisation de la panne se
fait très rapidement à l’aide de détecteurs
appropriés et l’on remplace l’élément
défectueux. Dans la plupart des cas, il s’agit d’un
élément " de jonction " auquel on
accède par les chambres de visite prévues à cet
effet. Ce type de réparation est relativement rapide. En cas
de " claquage " d’un câble (panne
extrêmement rare avec les câbles modernes), on doit
remplacer le tronçon défectueux (quelques centaines de
mètres) ce qui peut prendre entre 3 et 6 jours. Et nous savons
que certaines pannes survenant sur des lignes aériennes
exigent un temps de réparation aussi long et parfois même
plus long (lorsque de grands pylônes s’écroulent).
Pour les travaux de
génie civil, il existe un grand nombre d’engins qui
permettent d’enfouir des câbles dans n’importe quel
type de sol. Il existe même un engin spécial, nommé
" pelle-araignée " qui a été
spécialement conçu pour l’enfouissement des câbles
sur des terrains à très forte déclivité
(jusqu’à 70% et plus). Enfin, les trains mécanisés
permettent, jusqu’à 90 kV, de réduire de 30 % le
temps de pose des câbles. Leur utilisation n’est cependant
possible qu’en zones rurales.

La
pelle-araignée en action (source : La Vie Electrique –
n°254 – Sept. 1993). Conçue spécialement pour
les besoins des entreprises de génie civil qui travaillent
pour le compte d’EDF (notamment l’entreprise Denard), elle
peut creuser des tranchées à flanc de montagne (comme
ici dans les Pyrénées). Cet engin spectaculaire a
permis d’enfouir des ouvrages BT et HTA dans des secteurs où
les pentes atteignaient 80 % de déclivité. Les engins
les plus fréquemment utilisés sont la charrue-fileuse,
la charrue à soc vibrant, la charrue à soc araignée,
les trancheuses (pour sols gelés ou très durs) et les
cribleuses. On peut enfouir des câbles dans n’importe quel
type de sol mais la toute grande majorité des ouvrages
souterrains se trouve sous les routes et les trottoirs (comme à
Paris où la quasi-totalité des ouvrages 63 et 225 kV
sont sous les pieds des passants, à environ 1m,30 de
profondeur).
|
Sur les lignes 225 000 volts, 90 000 et
63 000 volts
L'enfouissement est techniquement maîtrisé et mis
en œuvre :
- Pour les lignes 225 000 volts, on réalise des tronçons dont
la longueur va jusqu'à 15 km,
- Pour les lignes 90 000 et 63 000 volts, les tronçons les
plus longs mesurent jusqu'à 30 km.
Il n’existe aucune raison technique (ou autre) limitant la longueur des liaisons 225 kV à 15 km. Idem pour les liaisons HTB 63/90 kV. Rien n’empêche de réaliser une liaison souterraine de 30, 40 ou 50 km en 225 kV. Il faut cependant prévoir la compensation de l’énergie réactive au delà de 30-35 km.
En ce qui concerne les liaisons souterraines 400 kV, nous trouvons, dans les archives techniques du CEPHES, un article paru en 1995 dans la revue professionnelle « Bâtiment Relations Elec » (n°9). Il avait pour titre « Insertion des lignes électriques dans l’environnement : quelle stratégie ? ». On peut y lire une interview de Mme M-P. Meynard, chef de service de l’Electricité à la direction du gaz, de l’électricité et du charbon (Digec) du Ministère de l’Industrie. Elle avait notamment déclaré que : « …Pour les lignes très haute tension de 400.000 volts, l’enfouissement n’est encore possible que pour de très courtes distances, soit environ 20 à 30 kilomètres… ». Il est donc utile de noter que, dans le jargon des technocrates du ministère de l’industrie, la notion de « courte distance » n’a pas du tout la même signification que chez EDF-RTE. Mme Meynard signalait, en outre qu’un programme de recherche était prévu par le « protocole-ligne « signé entre EDF et le gouvernement français. Elle faisait allusion aux recherches relatives aux ouvrages à isolation gazeuse qui permettent de concevoir des liaisons 380/400 kV de grande longueur (plusieurs centaines de kilomètres) ainsi qu’aux recherches relatives au développement industriel des câbles SC.
|
Cependant, la généralisation de ces solutions n'est pas
encore envisageable. En effet, les contraintes économiques sont
lourdes et la nature du sol ne permet pas toujours l'enfouissement.
De plus, il faudrait créer des stations de compensation tous les 25 à 30
km pour les lignes 225 000 volts et tous les 50 à 70 km pour les 90
000 et 63 000 volts, ce qui nécessiterait une emprise au sol
conséquente. Enfin, la mise en souterrain entraîne des interventions
plus longues et plus contraignantes en cas d'incident.
Le passage dans
des zones naturelles (biodiversité, Natura 2000) n'est pas
recommandé.
Pour les liaisons 63/90 kV, on devra compenser vers 60-70 km de longueur mais les lignes HTB d’une telle longueur sont pratiquement inexistantes (elles dépassent rarement les 50 km). Notons en passant qu’une station de compensation n’occupe pas plus de place au sol qu’une petite station de transformation. (un peu plus d'un hectare)
En ce qui concerne les " incidents " et les pannes, voir ce qui est dit plus haut.
Enfin, ce qui est dit à propos des " zones naturelles " est parfaitement ridicule puisque les ouvrages souterrains ou immergés n’agressent en rien l’environnement, contrairement aux lignes aériennes qui agressent TOUJOURS l’environnement !
Ce n’est pas parce que des écolos idiots se sont laissé berner dans le cadre de l’élaboration du contrat " Natura 2000 " que nous devons tous tomber aussi naïvement dans le panneau !
|
Enfouissement des lignes dans les autres pays
RTE est-il en retard par rapport à d'autres compagnies de
transport pour l'enfouissement de ses lignes électriques ?
Un examen
attentif des chiffres avancés par des pays comparables ou voisins de la
France aboutit à la conclusion inverse, surtout si l'on tient compte de la
densité de population.
|
Nous avons déjà
signalé que la France, donc RTE, était globalement en
retard vis-à-vis des autres pays de l’Union européenne.
Les remarques
insidieuses vis-à-vis de la " densité de
population " ne sont pas d’un intérêt
capital dans le cadre d’une analyse globale du problème.
Cette donnée n’a guère qu’un intérêt
économique pour l’exploitant. En effet, plus la densité
de population est élevée et plus l’ouvrage est
rentable, surtout à court terme. C’est ce qui conditionne
la notion de " TRI " (Taux de Rentabilité
Immédiate) chère aux analystes du duo RTE-EDF. C’est
pour cette raison que RTE rechigne à enfouir des ouvrages dans
les zones rurales à faible densité de populations. Le
coût par abonné desservi est, en effet nettement plus
élevé dans les campagnes et les petites villes que dans
les grandes agglomérations.
|
La France est l'un des pays les plus avancés
pour l'enfouissement de lignes dans les tensions comprises entre
150 000 et 230 000 volts (Très Haute Tension).
Situation internationale en 1998/1999
Pour les niveaux de tensions compris entre 149 000 et 229
000 volts, le taux d'enfouissement de la France est relativement élevé
(3,2%).
|
Pays |
Densité
de
population
dans le pays
(hab/km2) |
Kilométrage
de
circuits
enfouis
en>149
et <229 kV |
Pourcentage
de
kilométrage
enfoui
en>149
et <229 kV |
|
Pays-Bas |
388 hab/km2 |
6 km |
0,93 % |
|
France,
225 kV (RTE) |
108
hab/km2 |
798 km |
3,20 % |
|
Canada
(Ontario Hydro,Hydro
Québec-Transénergie) |
3
hab/km2 |
49 km |
0,36 % |
|
Espagne
(Endesa, Iberdrola,
Unión Fenosa, Hidroeléctrica del Cantábrico y Red Eléctrica de
España) |
78
hab/km2 |
75 km |
0,47 % |
|
Allemagne
(Bayernwerk, Bewag,
EnBW, HEW, Preussenelektra, RWE, VEAG, VEW) |
230
hab/km2 |
35 km |
0,16 % |
|
Italie
(ENEL) |
192
hab/km2 |
387 km |
2,83 % |
Source SYCABEL (Syndicat des
constructeurs de câbles électriques)
Pour la Haute Tension (tensions comprises entre
50 000 et 150 000 volts), la France est également bien placée,
notamment si l'on tient compte de sa densité de population.
|
Pays |
Densité
de
population
dans le
pays
(hab/km2) |
Kilométrage
de
circuits
enfouis
en >50
et <150 kV |
Pourcentage
de
kilométrage
enfoui
en >50
et <150 kV |
|
Pays-Bas |
388
hab/km2 |
905 km |
14,00 % |
|
France,
225 kV (RTE) |
108
hab/km2 |
1896 km |
3,80 % |
|
Canada
(Ontario Hydro, Hydro
Québec-Transénergie) |
3
hab/km2 |
215 km |
2,00 % |
|
Espagne
(Endesa, Iberdrola,
Unión Fenosa, Hidroeléctrica del Cantábrico y Red Eléctrica de
España) |
78
hab/km2 |
188 km |
0,58 % |
|
Allemagne
(Bayernwerk, Bewag,
EnBW, HEW, Preussenelektra, RWE, VEAG, VEW) |
230
hab/km2 |
4740 km |
6,20 % |
|
Italie
(ENEL) |
192 hab/km2 |
449 km |
1,20
% |
Source SYCABEL
|
Les tableaux utilisant des données " brutes "
(non corrigées) sont sans aucune valeur. C’est notamment
le cas pour les pourcentages calculés sur des bases
nationales. Ainsi, si nous considérons le réseau 225 kV
français, nous observons un pourcentage national de l’ordre
de 3 ,2 % en 1999 (environ 3,5 % à fin 2001). Mais si
nous considérons la ville de Paris, ce pourcentage est de 100
%. A l’inverse, dans la plupart des départements, il est
de …0 % !
Il en va de même
pour les ouvrages 63/90 kV.
Observons, par
ailleurs, que le Canada à une densité moyenne 36 fois
plus faible que la France. Si le raisonnement de RTE tenait la route,
son taux d’enfouissement devrait aussi être environ 36
fois moindre. Or, le tableau reproduit par RTE donne 0,36% pour le
Canada et 3,2 % pour la France. Il en résulte que le Canada a
fait un effort d’enfouissement quatre fois plus important que la
France dans la classe de tension considérée. Le calcul
est encore plus significatif pour les ouvrages de 50 kV à 150
kV puisque, dans ce cas, le Canada a fait un effort d’enfouissement
19 fois plus important que la France.
Cet exemple permet de
comprendre pourquoi il est inutile et dangereux de se référer
à des données brutes. Seul un expert compétent
est à même de les exploiter correctement
|
|


